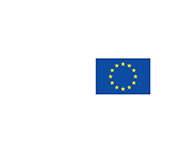
Choisissez la langue de votre document :
- bg - български
- es - español
- cs - čeština
- da - dansk
- de - Deutsch
- et - eesti keel
- el - ελληνικά
- en - English
- fr - français
- ga - Gaeilge
- hr - hrvatski
- it - italiano
- lv - latviešu valoda
- lt - lietuvių kalba
- hu - magyar
- mt - Malti
- nl - Nederlands
- pl - polski
- pt - português
- ro - română
- sk - slovenčina
- sl - slovenščina
- fi - suomi
- sv - svenska
|
| Procédure : 2010/2010(INI) |
| Cycle relatif au document : A7-0234/2010 | ||||||
Textes déposés : A7-0234/2010 | Débats : | Votes : PV 07/09/2010 - 6.9CRE 07/09/2010 - 6.9 Explications de votes | Textes adoptés : P7_TA(2010)0299 | |||
| Textes adoptés |
|
||||
| Mardi 7 septembre 2010 - Strasbourg | |||||
| Développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable |
|
|
Le Parlement européen, – vu la communication de la Commission intitulée «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), – vu la communication de la Commission intitulée «Intégrer le développement durable dans les politiques de l'UE: rapport de situation 2009 sur la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable» (COM(2009)0400), – vu la proposition de décision du Conseil relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres – partie II des lignes directrices intégrées «Europe 2020», présentée par la Commission (COM(2010)0193), – vu le règlement (CE) n° 106/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau(1), – vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments(2), – vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE(3), – vu le Livre blanc de la Commission intitulé «Adaptation au changement climatique: vers un cadre d'action européen» (COM(2009)0147) et la résolution y afférente du 6 mai 2010(4), – vu la communication de la Commission intitulée «Écologisation des transports» (COM(2008)0433), – vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie pour une mise en œuvre de l'internalisation des coûts externes» (COM(2008)0435), – vu la communication de la Commission intitulée «Une politique de l'énergie pour l'Europe» (COM(2007)0001), – vu les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009 et notamment leurs points 21-24, – vu le rapport de la Présidence du Conseil sur le rapport de situation 2009 sur la stratégie de l'UE en faveur du développement durable(5), – vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto à la CCNUCC, – vu le document publié par le GIEC en 2007 et intitulé «Bilan 2007 des changements climatiques: rapport de synthèse. Contribution des groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport d'évaluation du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat», – vu le rapport intitulé «2006 Stern Review Report on the Economics of Climate Change» (Rapport Stern 2006 sur la dimension économique des changements climatiques), – vu l'initiative Emplois verts 2008 du PNUE, de l'OIT, de l'OIE et de la CSI intitulée «Emplois verts: pour un travail décent dans un monde durable, à faibles émissions de carbone», – vu la note d'orientation de l'OIT intitulée «Global Challenges for Sustainable Development: Strategies for Green Jobs» (Défis mondiaux pour le développement durable: des stratégies pour la création d'emplois verts), présentée lors de la conférence des ministres de l'emploi du G8 organisée à Niigata (Japon) du 11 au 13 mai 2008, – vu la déclaration sur la croissance verte de l'OCDE, adoptée à la réunion du Conseil au niveau des ministres du 25 juin 2009, et à la stratégie pour une croissance verte menée par cette organisation, – vu le rapport de Greenpeace et du European Renewable Energy Council (EREC – Conseil européen des énergies renouvelables) de 2009 intitulé «Working for the climate: renewable energy and the green job revolution» (Œuvrer pour le climat: les énergies renouvelables et la révolution des emplois verts), – vu le rapport publié en 2007 par la Confédération européenne des syndicats (CES) et l'Agence pour le développement social (SDA) sous le titre «Changement climatique et emploi – Impact sur l'emploi du changement climatique et des mesures de réduction des émissions de CO2 dans l'Union européenne à 25 à l'horizon 2030», – vu l'Economic Paper 156 de la Ruhr, intitulé ' Economic impacts from the Promotion of Renewable Energy Technologies, The German Experience' (Impacts économiques résultant de la promotion des technologies en matière d'énergies renouvelables: l'expérience de l'Allemagne), – vu la publication du CEPOS, intitulée «Wind Energy, the case of Denmark» (Énergie éolienne: le cas du Danemark), – vu la publication de l'Université Rey Juan Carlos, intitulée ' Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources' (Étude des effets sur l'emploi des aides publiques aux énergies renouvelables), – vu la communication de la Commission du 14 décembre 2007 sur les marchés publics avant commercialisation (COM(2007)0799), – vu le rapport de la Commission intitulé «L'emploi en Europe» de 2009 et, en particulier, son chapitre 3 intitulé «Climate change and labour market outcomes» (Changement climatique et répercussions sur le marché de l'emploi), – vu la communication de la Commission intitulée «Un plan européen pour la relance économique» (COM(2008)0800) et la résolution y afférente du 11 mars 2009(6), – vu la communication de la Commission intitulée «L'Europe, moteur de la relance» (COM(2009)0114), – vu l'analyse commune des partenaires sociaux européens du 18 octobre 2007 intitulée «Défis essentiels auxquels les marchés européens du travail sont confrontés», – vu le cadre d'actions des partenaires sociaux de 2002 pour le développement des compétences et des qualifications tout au long de la vie, – vu la communication de la Commission intitulée «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux – Anticiper et faire coïncider les compétences requises et les besoins du marché du travail» (COM(2008)0868), et le rapport du groupe d'experts intitulé «New Skills for New Jobs: Action Now»(De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois: agir immédiatement) de février 2010, – vu la note d'orientation du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (CEDEFOP) de 2009 intitulée «Future Skills Needs for the Green Economy» (Besoins futurs en matière de compétences pour l'économie verte), – vu l'article 48 du règlement, – vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission du développement régional et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0234/2010), A. considérant que le Conseil européen de 2009 a réaffirmé que le développement durable constituait l'un des objectifs essentiels du traité de Lisbonne; considérant que la prise en considération intégrée des intérêts économiques sociaux et écologiques, l'intensification du dialogue social, le renforcement de la responsabilité sociale des entreprises et les principes de précaution et du pollueur-payeur comptent parmi les lignes de force de la stratégie communautaire en faveur du développement durable, B. considérant que la stratégie Europe 2020 met notamment l'accent sur la promotion d'une économie sociale, économe en ressources, respectueuse de l'environnement et compétitive, C. considérant que les nations industrialisées doivent, selon l'accord de Copenhague, réduire, d'ici 2050, leurs émissions de C02 de 80 à 90 % par rapport au niveau de 1990, D. considérant que l'incidence du changement climatique en Europe varie d'une région à l'autre, que selon l'étude(7) menée sur le sujet par la Commission, les régions situées dans le Sud et l'Est de l'Europe, dans lesquelles vit plus d'un tiers de la population de l'Union, sont particulièrement sujettes à la pression du changement climatique, que les groupes de population les plus vulnérables sont les plus durement touchés et qu'il peut en résulter des déséquilibres régionaux et sociaux plus marqués, E. considérant que le passage à une économie plus durable a des répercussions diversement positives en fonction des secteurs et qu'il entraîne, en particulier, la création, le remplacement ou la disparition partielle d'emplois, que la nécessaire adaptation de l'ensemble des emplois à des modes de production et de travail durables et économes en ressources implique des changements en profondeur dans les relations de travail existantes, dont il faut souhaiter qu'elles soient souples, F. considérant, selon les chiffres figurant dans le livre vert sur les changements démographiques (COM(2005)0094), que de 2005 à 2030, la population active de l'Union perdra 20,8 millions de personnes (6,8 %) et que le nombre des plus de soixante ans s'accroît deux fois plus vite qu'avant 2007 – soit de deux millions environ chaque année, contre un million auparavant, G. considérant que cette évolution peut stabiliser l'emploi et faire augmenter le nombre de postes de travail, et avoir des retombées significatives dans d'autres secteurs; considérant, en outre, que l'on observe, moyennant la mise en place d'un contexte fiable, une amélioration constante des possibilités d'embauche et de la sécurité de l'emploi qui est stabilisée par des exportations en hausse, H. considérant que si les entreprises et les chercheurs européens n'arrivent pas à traduire en produits commerciaux le résultat de leurs travaux, la croissance économique escomptée et les créations d'emplois en résultant dans une économie basée sur l'innovation ne seront pas au rendez-vous; considérant que le tableau de bord de l'innovation de la Commission met en lumière un déficit de 30 % avec les États-Unis dans ce domaine et de 40 % avec le Japon, I. considérant que dans certains nouveaux secteurs, les structures du dialogue social n'existent pas encore; qu'on observe des cas de nouveaux secteurs où les accords tarifaires n'existent pas ou que, quand il y en a, ils ne sont pas appliqués et que des codes sectoriels font également défaut; considérant que tous les secteurs doivent faire face à une forte pression les poussant à gagner en compétitivité et que les travailleurs des régions fortement affectées par le chômage sont poussés à accepter des conditions de travail médiocres, J. considérant qu'au cours de ces deux dernières décennies, une insécurité de l'emploi à long terme s'est développée sur le marché du travail européen, où de plus en plus de jeunes, en particulier, se voient proposer des contrats à court terme précarisés; considérant que les nouveaux emplois créés dans ces conditions ne peuvent être considérés comme durables et que, pour développer le potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable, il convient de remédier à ces défaillances structurelles, K. considérant que la transition vers une nouvelle économie durable ne devrait pas servir de prétexte pour exclure les travailleurs les plus vulnérables et les moins qualifiés du marché de l'emploi et considérant, par conséquent, la nécessité d'éviter l'effet d'écrémage dont les travailleurs les moins qualifiés seront les premières victimes, L. considérant que le principe d'égalité des genres est consacré par le traité de Lisbonne et figure parmi les objectifs de développement du millénaire, que les femmes sont sous-représentées dans différents secteurs et ne profitent donc pas dans la même mesure des emplois créés par la nouvelle économie durable, M. considérant que la nouvelle économie prendra forme dans une société vieillissante dont la population active diminuera, ce qui rendra nécessaire d'attirer davantage les femmes à accomplir un travail rémunéré et ce, grâce à l'adaptation de l'organisation du travail et à la préparation des employeurs dans tous les secteurs à une diversification accrue de la population active, N. considérant que, selon des études récentes, la présence des femmes à tous les niveaux de responsabilités représente une valeur ajoutée pour les entreprises, notamment par rapport à leur performance économique, O. considérant que les femmes obtiennent la majorité des diplômes des universités de l'Union, qu'elles sont majoritaires dans les études de commerce, de gestion et de droit, mais qu'elles restent minoritaires dans les postes à responsabilité des entreprises et des administrations, P. considérant que, notamment en raison de la présence de stéréotypes sexistes dans l'éducation et dans la société, les femmes sont sous-représentées dans les domaines considérés à tort comme «masculins», tels que l'informatique, l'ingénierie, la physique et les métiers techniques, par exemple la mécanique et la maçonnerie, Q. considérant que le chômage des travailleurs âgés augmente et que ces personnes sont victimes d'un phénomène d'exclusion sociale de plus en plus prononcé au-delà de 55 ans et que, malgré les progrès enregistrés depuis une dizaine d'années, seulement un peu plus de 30 % des femmes âgées de 55 à 64 ans avaient un emploi en 2008, alors que cette proportion était de 55 % parmi les hommes de la même catégorie d'âge, Stratégie de l'emploi pour une nouvelle économie durable 1. considère que le développement durable repose sur une vision à long terme dans laquelle croissance économique, cohésion sociale et protection de l'environnement vont de pair et se soutiennent mutuellement; souligne le potentiel que représente la création d'emplois verts dans une économie durable; 2. estime que l'économie de l'après-crise offre une excellente possibilité de croissance durable fondée sur la justice sociale et l'éco-efficacité; fait observer que la transformation des économies européennes polluantes en économies éco-efficaces induira des changements profonds dans la production, la distribution et la consommation, ce qui devrait être mis à profit pour progresser vers une véritable durabilité, sans remettre en cause la prospérité ou l'emploi; estime que la transition vers une économie basée sur les énergies non polluantes doit être perçue comme une chance d'investir dans le développement durable, et non pas seulement comme une charge sur les budgets publics et privés; 3. souligne l'importance des mesures visant à promouvoir la croissance et l'emploi dans les campagnes pour enrayer l'exode rural; 4. constate qu'il est nécessaire de rendre la production des biens et des services plus durable; constate que les investissements consentis dans une nouvelle économie durable recèlent un important potentiel de croissance pour le marché de l'emploi et des ressources financières nouvelles; que ce bilan positif s'accompagne de pertes dans certains secteurs et estime dès lors que la formation continue et la reconversion doivent être encouragées; 5. estime que la crise économique et sociale qui sévit actuellement dans le monde et qui a freiné les changements en matière de consommation d'énergie et la réduction des émissions de carbone ne devrait pas dissuader les États membres de s'acheminer vers une économie à faible intensité de carbone et économe en ressources qui se voudrait compétitive et plus durable, dans la mesure où cette transition les rend plus résistants, moins dépendants vis-à-vis d'importations dont le coût demeure élevé, et plus concurrentiels; 6. estime qu'il faudrait faire davantage pour internaliser les coûts externes; demande à la Commission d'utiliser les instruments politiques existants, ou d'en développer de nouveaux si nécessaire, pour imputer les coûts et de faire en sorte que les conclusions soient prises en compte dans les futures propositions politiques; 7. considère qu'une nouvelle économie durable de l'Union européenne doit garantir un développement économique et social équilibré; plaide pour une politique industrielle ambitieuse et durable, qui mette l'accent sur l'efficacité dans l'utilisation des ressources; souligne qu'une économie verte se doit d'offrir des possibilités d'emplois bien payés et assortis de conditions convenables, et de mettre l'accent sur la protection de l'environnement; 8. est fermement convaincu qu'une politique environnementale, fondée sur l'économie de marché, est de nature à produire de la croissance et des emplois dans l'ensemble des secteurs d'activité et souligne que les entreprises innovantes sauront faire le meilleur usage de ces possibilités et œuvrer en faveur de l'environnement et des travailleurs si elles peuvent compter sur des conditions d'ensemble prévisibles et propices aux investissements; 9. demande que l'industrie s'engage dans l'éco-innovation, dans la mesure où les entrepreneurs ont un très grand rôle à jouer dans une diffusion plus large de l'éco-innovation; fait remarquer, à cet égard, que l'information des entrepreneurs - par la mise en relief des nouvelles possibilités qui s'ouvrent aux entreprises - est primordiale pour assurer le succès d'une stratégie visant à développer une utilisation plus efficace des ressources et des industries durables; 10. soutient l'initiative qui sous-tend la stratégie Europe 2020 de la Commission, destinée à réaliser dès à présent le passage à une économie durable, à limiter le rapport de dépendance entre croissance économique, d'une part, et consommation de ressources et d'énergie, d'autre part, à réduire les émissions nocives pour l'environnement et contrer ce faisant le réchauffement de la planète; salue la volonté manifestée d'axer l'environnement législatif, les incitations économiques, les subventions et les marchés publics en faveur de la réalisation de cet objectif; déplore toutefois que la Commission ait négligé de se pencher, dans la stratégie Europe 2020, sur le potentiel du marché de l'emploi d'une économie durable; 11. constate qu'afin d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'emploi, de tirer pleinement parti du potentiel d'emplois d'une nouvelle économie durable et d'améliorer la durabilité de la production de biens et de services, il est nécessaire d'accroître l'efficacité énergétique des habitations et de la construction, la part des énergies renouvelables, des technologies favorables à l'environnement, du transport durable et de la mobilité, la durabilité de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche et le conseil par l'intermédiaire des services environnementaux, de même que le recyclage, les processus de production faiblement consommateurs de ressources et l'utilisation des matériaux en cycles fermés; constate, en outre, que le secteur des services ainsi que le secteur de l'économie sociale recèlent eux aussi un important potentiel d'emplois verts; 12. insiste sur l'importance que revêt le secteur public, en montrant l'exemple, en adoptant des normes avancées pour les marchés publics, en prévoyant des incitations et en diffusant des informations, en particulier dans les domaines de l'énergie, de la construction d'infrastructures et d'équipements, des transports et des communications, pour la création d'emplois assortis de droits; demande à la Commission et aux États membres de favoriser, notamment pour les achats publics avant commercialisation, l'inclusion de normes environnementales, sociales et éthiques tout en privilégiant les clauses de «contenu local» et les entreprises de l'économie durable et solidaire, en particulier les PME; 13. invite instamment les États membres à procéder à un échange d'expérience et de meilleures pratiques dans le domaine des possibilités d'emploi lorsqu'ils s'occupent de l'impact économique, social et environnemental du changement climatique; 14. est convaincu que les emplois verts durables ne sauraient constituer un phénomène annexe, mais que l'ensemble de l'économie et de la société doit aspirer à une évolution basée sur le principe de durabilité; sait pertinemment qu'il n'existe pas de secteur d'activité clairement identifiable dédié à la «protection de l'environnement» ou à l'«industrie de l'environnement» car l'activité dite de protection de l'environnement englobe de nombreux secteurs traditionnels tels que l'industrie manufacturière, le BTP ou les services; invite par conséquent à adopter la définition de l'OIT, en vertu de laquelle tous les emplois propices au développement durable sont des emplois verts durables, comme définition opérationnelle; précise que cette définition englobe d'une part les emplois qui contribuent directement à la réduction de la consommation d'énergie et de matières premières, à la protection des écosystèmes et de la biodiversité et à la réduction de la production de déchets et de la pollution atmosphérique, et d'autre part l'ensemble des emplois qui permettent de réduire l'empreinte écologique; convient que le potentiel d'emplois ne peut être précisément circonscrit au vu de l'étendue de cette définition; 15. est d'avis qu'un nombre bien plus important de projets de recherche est nécessaire pour mesurer l'impact des politiques environnementales et de lutte contre le changement climatique sur la création nette d'emplois; demande à la Commission d'en faire une priorité dans le cadre du 8e programme-cadre; 16. souligne que tous les emplois doivent concourir à la réalisation d'un développement durable et que les modes de production et de travail doivent être conçus en vue d'une utilisation aussi efficace que possible des matériaux, des ressources et de l'énergie; ajoute que cette approche doit valoir à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et qu'établir une distinction entre bonnes et mauvaises activités n'a aucun sens, étant donné que toutes les branches peuvent gagner en durabilité; 17. juge essentiel de garantir un nouveau cadre communautaire, doté de crédits appropriés et suffisants, pour soutenir la recherche publique et assurer, par des mécanismes simples et sans bureaucratie, la diffusion des résultats obtenus pour favoriser l'innovation dans toutes les entreprises, notamment dans les microentreprises et dans les petites et moyennes entreprises, qu'il s'agisse d'efficacité énergétique, de recours à de nouvelles sources d'énergie et à de nouveaux processus de production ou de recyclage et d'une meilleure utilisation des ressources, ce qui entraînera la création d'emplois assortis de droits; Optimaliser le potentiel d'emplois 18. demande le développement d'une stratégie européenne de l'emploi allant dans le sens d'une économie durable, dans le cadre de la stratégie Europe 2020, visant à optimiser le potentiel d'emplois tout en accordant une attention particulière au travail décent, à la santé et à la sécurité des salariés, aux besoins en compétences et à une transition socialement juste; souligne qu'une économie durable se doit d'associer les durabilités sociale, technologique, économique et environnementale; souligne que cette stratégie de l'emploi basée sur le principe de durabilité doit constituer un élément central des lignes directrices pour les politiques de l'emploi; 19. recommande aux autorités régionales de veiller à ce que leur stratégie de développement réponde aux objectifs de la stratégie Europe 2020 pour la création d'emplois dans une économie durable; 20. invite la Commission à proposer, d'ici à 2011, une stratégie comprenant des mesures législatives et non législatives visant à encourager les emplois verts qui sont une source de croissance et de prospérité pour tous; 21. fait observer que les entreprises européennes, fortes de leur capacité à innover, se sont donné les moyens de jouer un rôle de pionnier dans la protection de l'environnement; est toutefois préoccupé par la délocalisation continue à grande échelle de productions européennes vers des pays tiers où les normes de protection environnementales sont bien moins élevées; invite instamment la Commission et les États membres à lutter rapidement et énergiquement contre ce phénomène en mettant en œuvre une approche mondiale et multilatérale qui garantit l'existence d'obligations comparables dans le contexte concurrentiel mondial; 22. souligne qu'un cadre réglementaire stable, inscrit dans le long terme et ambitieux est une condition préalable nécessaire pour réaliser pleinement le potentiel d'emplois verts; demande à la Commission et aux États membres de définir des normes environnementales et des incitations financières qui permettent d'établir un environnement fiable pour dix ans au moins et de garantir ce faisant la sécurité juridique et la programmation; demande que l'on tire parti des instruments financiers existants pour promouvoir la durabilité et que l'accroissement de la durabilité de l'activité et de la production économiques soit inclus dans les perspectives financières des différents Fonds, y compris des Fonds structurels et du Fonds de cohésion, à titre d'objectif prioritaire; 23. insiste, à cet égard, sur l'importance du concept de développement urbain intégré et sur le fait que le réaménagement durable de quartiers urbains défavorisés pourrait servir de modèle; estime que l'une des conditions pour y parvenir est l'établissement d'un cadre politique clair, y compris le maintien de la promotion de la dimension urbaine dans les Fonds structurels; 24. souligne la nécessité d'affecter des financements, au sein des programmes existants, à la réalisation d'études ciblées sur les régions les plus défavorisées de l'Union, pour déterminer les objectifs stratégiques spécifiques et la nature des interventions indispensables pour créer des conditions favorables au développement d'économies locales durables, ayant pour objectif spécifique de créer des emplois verts et de mener des actions intégrées susceptibles d'attirer de nouvelles entreprises vertes et de soutenir celles qui sont déjà en place; 25. souligne que les investissements axés sur la transition verte des régions défavorisées de l'Union constituent l'un des instruments les plus utiles pour la réalisation des objectifs stratégiques de la convergence régionale et de la cohésion territoriale; 26. insiste sur l'importance du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour la formation de pôles régionaux («clusters») par le regroupement, au niveau local, de la recherche, de l'innovation et de l'infrastructure dans le domaine des nouvelles technologies, par exemple pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique; souligne, par ailleurs, que dans les régions urbaines notamment, les autorités locales et régionales sont les mieux placées et les plus compétentes pour mettre en place les conditions nécessaires à l'essor des pôles («clusters») d'entreprises innovantes; fait remarquer que de tels regroupements peuvent donner une impulsion décisive au développement économique local et créer de nouveaux emplois dans les régions; 27. a bien conscience de ce que les systèmes de financement aux niveaux régional, national ou européen demeurent sans véritable coordination et souligne donc la nécessité d'une meilleure coordination à plusieurs niveaux entre les programmes et l'intérêt d'une synergie accrue entre les diverses politiques communes qui font appel aux Fonds structurels, aux fonds de développement agricole ou rural, au programme-cadre pour la recherche et au programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité, coordination et synergie qu'il s'agit de concevoir pour parvenir à une économie durable et économe en ressources; est convaincu qu'en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, il importe d'examiner plus avant la possibilité d'accentuer encore le transfert des moyens destinés à cette politique du versement d'aides directes vers le développement rural et le développement d'une agriculture durable, respectueuse de l'environnement; 28. invite à nouveau la Commission et les États membres à capitaliser les succès du Fonds pour la reconstruction et à mettre en place une nouvelle initiative commune, avec des projets-pilotes, pour la reconstruction d'une économie durable nouvelle; 29. rappelle que le point 8 des conclusions du Conseil du 21 octobre 2009 invite la Commission à revoir d'urgence, secteur par secteur, les subventions qui ont un impact négatif sur l'environnement et qui sont incompatibles avec le développement durable; demande à la Commission de mettre en œuvre sans tarder ces conclusions en étudiant les redéploiements budgétaires possibles de ces subventions vers le soutien aux nouvelles activités liées à l'économie durable; 30. demande que des systèmes de financement et des incitations fiscales efficaces soient mis en place pour aider les PME à s'orienter vers des stratégies d'emplois respectant l'environnement et à garantir des innovations et une production écologiques; 31. est d'avis que la législation environnementale – actuelle et proposée – de l'Union offre des possibilités considérables de créer de nouveaux emplois dans des domaines tels que l'air, les sols, l'eau, l'énergie, les services publics, l'agriculture, les transports, la sylviculture et la gestion de l'environnement; demande aux États membres de mettre en œuvre la législation de l'Union qui pourrait conduire à de nouveaux investissements dans des technologies et des emplois respectueux de l'environnement; 32. rappelle que la passation des marchés publics constitue une large part de marché et pourrait prévoir des incitations significatives pour rendre l'économie plus écologique; demande par conséquent que dans tous les marchés publics, des normes environnementales élevées soient exigées; 33. demande à l'Union européenne et à ses États membres d'anticiper les changements, de lever les doutes et incertitudes en matière d'information et de favoriser la sensibilisation, les processus d'apprentissage social et l'évolution des modes de consommation; affirme la nécessité de mettre en place des incitations pour que les entreprises investissent plus dans les technologies propres et que les travailleurs sont davantage prêts à faire face au changement moyennant l'existence de perspectives d'emploi et d'un filet de sécurité; 34. souligne que la nécessité de développer le potentiel d'emplois de qualité dans une nouvelle économie durable exige d'orienter l'innovation vers des solutions qui apportent des réponses aux grands défis de société, comme le chômage et la pauvreté, le changements climatique, le vieillissement de la population ou la raréfaction des ressources; attire l'attention sur la pertinence d'une politique industrielle et d'une politique de recherche basées sur l'innovation ouverte et sur les grappes d'entreprises («clusters»), afin d'encourager la mise en commun de savoirs entre les différents acteurs économiques publics et privés et d'encourager l'innovation; invite à cet égard la Commission à édifier une plateforme technologique européenne pour des industries peu gourmandes en ressources; 35. recommande que, dans le cas où un État membre déciderait de subventionner, par exemple, l'augmentation de la production d'énergie éolienne, biologique ou solaire, le niveau des subventions se fonde sur une évaluation scientifique des données empiriques et que les subventions offrent des perspectives raisonnables d'investissements ainsi qu'une certaine sécurité aux investisseurs éventuels, et invite à étudier soigneusement certains facteurs, comme l'augmentation des emplois nets créés grâce aux subventions, le cours de l'énergie, l'influence nette sur les émissions de gaz à effet de serre et sur d'autres polluants, afin que, de la sorte, le gain en durabilité soit optimal; 36. fait observer qu'il n'existe aucun consensus concernant les solutions technologiques censées être les plus durables sur les plans environnemental, économique ou social dans la situation de concurrence mondiale; constate qu'il convient de tenir compte d'un grand nombre de variables lorsqu'on compare, par exemple, la durabilité de la production d'énergie des éoliennes, celle des PV panneaux solaires, celle de la combustion de charbon avec captage et stockage du dioxyde de carbone et celle des réacteurs nucléaires ou celle d'autres technologies; appelle donc à la réalisation de nouvelles études scientifiques sur le sujet, en recourant à des comparaisons entre les cycles de vie complets de production, et invite à rendre tous les processus de production plus efficaces du point de vue de l'utilisation des ressources; Potentiel d'emplois pour les hommes et les femmes au sein de la nouvelle économie durable 37. souligne que l'augmentation de la participation des femmes au marché du travail européen est la seule manière de pouvoir tirer pleinement parti du potentiel en matière de croissance et d'emploi au sein de la nouvelle économie, sachant que le fait de combler l'écart entre le taux d'emploi des hommes et celui des femmes a compté pour plus de la moitié de l'augmentation du taux d'emploi pour l'ensemble de l'Europe et pour un quart de la croissance économique annuelle depuis 1995, et dans la mesure où il s'agit d'une condition préalable pour garantir une croissance durable et répondre aux besoins de la transformation écologique dans une société vieillissante; 38. appelle à une initiative au niveau de l'Union européenne afin de sensibiliser les employeurs, en particulier ceux des secteurs où dominent traditionnellement les hommes, à la nécessité et aux avantages d'une main d'œuvre plus diversifiée au sein d'une société vieillissante, et de leur offrir les outils qui leur permettront de se préparer à une diversité accrue; 39. demande à l'Union, aux États membres et aux partenaires sociaux de combattre la discrimination et de promouvoir l'égalité des genres dans une économie durable, de créer des environnements de travail susceptibles d'attirer les femmes dans les secteurs concernés et de les y maintenir, d'œuvrer pour mieux concilier vie familiale et activité professionnelle en s'appuyant sur une offre suffisante et de qualité de services de garde d'enfants et en aménageant le poste de travail de manière à répondre aux besoins des familles, de créer les possibilités et les conditions dans le cadre desquelles hommes et femmes pourront participer au marché du travail sur un pied d'égalité, d'accroître la part des femmes dans des structures représentatives majoritairement masculines et de réduire la segmentation de l'emploi en fonction du genre ainsi que les écarts salariaux; 40. souligne que l'investissement dans les infrastructures sociales constitue une occasion de moderniser l'Europe et de promouvoir l'égalité, et qu'il peut être perçu comme une stratégie parallèle à la modernisation des infrastructures physiques par l'investissement dans les technologies vertes; considère que l'égalité entre les femmes et les hommes doit donc être une priorité politique et un outil indispensable; 41. souligne qu'un effort ciblé visant à garantir aux femmes l'accès à l'éducation à tous les niveaux, en luttant contre les stéréotypes sexistes, ainsi qu'à permettre un apprentissage tout au long de la vie revêt une importance capitale pour mettre fin à la ségrégation des hommes et des femmes sur le marché du travail; appelle à une formation adéquate afin d'empêcher la sous-représentation des travailleuses dans les emplois verts, en gardant à l'esprit que le renoncement massif des femmes aux sciences et aux technologies ferait obstacle à la croissance et à la durabilité européennes et laisserait de nombreuses jeunes femmes douées et qualifiées en marge de toute certitude économique et de l'emploi; 42. appelle à une initiative européenne spécifique visant à attirer les filles vers les professions MINT (mathématiques, informatique, sciences naturelles et technologie) et à lutter contre les stéréotypes qui règnent toujours au sein de ces professions; souligne que le rôle des médias et de l'éducation sont essentiels pour lutter contre ces stéréotypes; 43. souligne qu'il y a lieu d'orienter les jeunes femmes, au moment de la transition entre les études et le marché du travail, vers les secteurs où elles sont sous-représentées, en encourageant l'école, l'université, l'institut de formation et l'entreprise à partager le parcours de formation, afin que les femmes acquièrent des compétences et des capacités concrètes, également à un niveau élevé et spécialisé, grâce à l'expérience du travail dans le cadre d'emplois réguliers et non précaires offrant une perspective d'accomplissement; 44. demande à l'Union européenne et aux États membres d'accorder une priorité accrue, au titre des programmes du Fonds social européen (FSE), aux emplois «verts» pour les femmes, en tenant compte des projets de formation financés par le FSE dans des domaines tels que l'énergie renouvelable et l'écotourisme; souligne qu'il convient d'intensifier les efforts pour augmenter, dans les projets bénéficiant du soutien du FSE, le taux de participation féminine, qui se situe actuellement en deçà de 10 %; appelle à l'inscription de crédits consacrés aux questions de genre au budget du FSE, ainsi qu'à la mise en œuvre de plans de relance et de programmes d'ajustement structurel visant à garantir que de tels programmes attirent et intègrent également les femmes; 45. fait observer que la transition vers une nouvelle économie ne doit pas servir de prétexte pour restreindre différentes mesures d'égalité, mais doit au contraire être considérée comme une occasion unique d'accroître la participation des femmes sur le marché du travail de l'Union européenne, puisqu'il s'agit d'une condition préalable pour garantir une croissance durable, tirer pleinement parti du potentiel d'emplois et renforcer la compétitivité; Travail décent 46. invite la Commission à prendre aussi en compte, outre le potentiel d'emplois hautement qualifiés, les nombreux emplois de niveau de qualification moyen et peu élevé dans l'économie durable, ainsi que les travailleurs peu qualifiés mais spécialisés; demande à la Commission et aux États membres de tenir particulièrement compte de cet élément dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi; invite les État membres à revaloriser les emplois en question et à garantir un travail décent; 47. souligne la nécessité d'accorder une attention toute particulière au travail décent, aux besoins en qualifications et à une transition socialement juste; demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux de s'assurer que tous les citoyens européens tirent parti d'une stratégie d'emploi en faveur d'une économie durable; souligne la nécessité d'inclure tous les types d'emplois dans cette stratégie, les emplois hautement qualifiés tout comme les emplois moyennement ou faiblement qualifiés; demande que les opportunités dans les domaines de l'éducation, de la recherche et du développement soient augmentées; demande en outre que, tant dans les lignes directrices pour les politiques de l'emploi que dans le programme de la Commission intitulé «De nouvelles compétences pour de nouveaux emplois», l'accent soit particulièrement mis sur les travailleurs les plus éloignés du marché de l'emploi, les plus vulnérables, notamment les personnes handicapées, et les moins qualifiés, et sur la protection de ces travailleurs; 48. estime que la politique de l'emploi joue un rôle central dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, et préconise dès lors, conformément au programme de l'OIT pour un travail décent, des conditions de travail de qualité et des rémunérations qui soient propres à garantir des conditions d'existence dignes tout en contribuant de manière adéquate au PIB; 49. constate que, compte tenu du degré d'organisation souvent plus faible des travailleurs et des employeurs dans certains nouveaux secteurs, le risque existe de voir s'y instaurer des relations de travail précaires et de mauvaises conditions de travail; demande à l'Union et aux États membres de poser les bases nécessaires à la mise en place de structures représentatives dans les secteurs en question; demande aux partenaires sociaux de s'organiser et invite la Commission à promouvoir l'échange des meilleures pratiques au niveau de l'Union, notamment sur le renforcement de la procédure d'information et de consultation des travailleurs et sur la mise en place de comités d'entreprise européens; 50. observe que d'autres efforts sont nécessaires afin d'assurer une harmonisation effective par l'Union des exigences minimales d'organisation de l'horaire de travail en rapport avec la santé et la sécurité des travailleurs; 51. invite les États membres à élaborer, en coopération avec les partenaires sociaux, des programmes intégrés d'évaluation des initiatives de passage à l'économie verte aux niveaux à la fois local et national; invite les partenaires sociaux à mettre au point des mécanismes d'évaluation de la contribution des travailleurs à la stratégie du développement durable, en proposant et en appliquant, ensuite, des politiques d'encouragement à la participation efficace à la fois à la mobilité durable des travailleurs et au développement «vert»; 52. demande aux partenaires sociaux de s'ouvrir aux nouveaux secteurs et d'élaborer des stratégies visant à intégrer les associations sectorielles dans le système de concertation sociale; 53. demande à l'Union et aux États membres de lier plus étroitement les subventions publiques et les achats publics au respect de normes sociales minimales à l'échelon des États membres et d'accélérer la mise en place de structures représentatives des partenaires sociaux; 54. fait observer que les actions de formation professionnelle et d'apprentissage tout au long de la vie en direction des salariés, qui accompagnent la mutation des processus de production des entreprises ou des secteurs, se traduisent également par la création de nouveaux emplois; demande à l'Union d'élaborer un cadre susceptible d'anticiper les changements et les restructurations, notamment de la production, et qui ouvre à l'ensemble des travailleurs le droit de participer aux programmes de formation et d'apprentissage tout au long de la vie; demande aux États membres, aux employeurs et aux travailleurs de reconnaître que gestion des compétences, formation et apprentissage tout au long de la vie relèvent de leur responsabilité partagée, comme l'affirme l'accord-cadre sur l'apprentissage tout au long de la vie conclu par les partenaires sociaux en 2002; demande à la Commission d'inclure dans le cadre pour l'apprentissage tout au long de la vie une neuvième compétence-clé relative à l'environnement, au changement climatique et au développement durable, compétence essentielle dans une société fondée sur la connaissance; invite les États membres à intégrer dans la formation initiale, l'éducation et la formation tout au long de la vie, la notion d'économie durable; 55. invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à redoubler d'efforts pour remédier efficacement aux effets néfastes des restructurations à la fois sur l'économie locale et sur le marché de l'emploi; souligne la nécessité de diffuser des recommandations sur la gestion du changement et ses répercussions sociales; Répondre aux besoins en termes de compétences 56. souligne que les États membres doivent adapter leurs systèmes d'éducation et de formation et concevoir et mettre en œuvre des programmes d'action ciblés pour la reconversion des travailleurs dans des domaines susceptibles d'être affectés par la transformation des économies locales en une nouvelle économie durable, de manière à leur assurer la possibilité d'accéder aux nouveaux emplois «verts», pour permettre à la main-d'œuvre d'aligner ses compétences sur les besoins du marché de l'emploi d'une économie durable fondée sur des concepts de formation basés sur les compétences; salue, dans ce contexte, l'initiative de la Commission intitulée «Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux» et voit dans la coopération avec les États membres un premier pas dans la bonne direction; fait toutefois observer qu'il convient d'établir un lien plus étroit entre cette initiative et les objectifs fixés dans la décision du Conseil sur le développement durable et de mettre en œuvre, tant au niveau de l'Union que dans les États membres, des actions concrètes s'inscrivant dans le prolongement de cette initiative; 57. souligne la nécessité de recourir à la méthode ouverte de coopération et à l'échange de bonnes pratiques en ce qui concerne le développement durable, les emplois verts et l'apprentissage tout au long de la vie, de manière à assurer une gestion heureuse et efficace du changement économique et, par extension, des nouveaux besoins en formation mais aussi des conséquences sociales défavorables que comporte cette transition; 58. demande aux États membres de lutter contre la discrimination sur la base de l'âge et d'adapter les offres de formation et les stratégies d'apprentissage tout au long de la vie aux besoins des travailleurs âgés, en vue de garantir un niveau élevé de participation à l'emploi des travailleurs et des travailleuses de plus de 55 ans; 59. invite l'Union et les États membres à adopter des politiques détaillées en matière d'innovation et de créativité, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la formation, y compris l'enseignement et la formation professionnels, pour poser les fondements d'une économie, d'une compétitivité et d'une prospérité vertes; 60. constate que pendant les périodes de crise, il est essentiel d'attirer les jeunes vers les nouveaux types d'emplois «verts» et d'assurer que les programmes de qualification encouragent l'accès des jeunes au marché du travail, afin que ces derniers puissent tirer parti du potentiel en matière d'emploi, tant pour lutter contre le chômage élevé des citoyens de moins de 25 ans que pour valoriser les compétences des jeunes générations concernant l'utilisation des nouvelles technologies; regrette que l'initiative phare de la stratégie Europe 2020, intitulée «Jeunesse en action», exclue les jeunes qui ne suivent pas un cursus d'enseignement supérieur; souligne que, si l'on veut parvenir à un véritable changement, il faut se concentrer sur les jeunes qui ont aujourd'hui le moins de perspectives et risquent de sombrer dans la pauvreté; 61. invite les États membres à concevoir, en coopération avec les partenaires sociaux, et à mettre en œuvre des programmes d'orientation professionnelle, à l'adresse des jeunes, destinés à les orienter vers les secteurs scientifiques et technologiques qui encouragent le développement d'une économie viable et durable, et des activités d'information et de sensibilisation aux questions d'écologie et d'environnement, dans le cadre à la fois des structures du système scolaire et des activités des collectivités locales et régionales; 62. invite la Commission à collaborer plus étroitement avec les États membres en vue d'établir des prévisions à moyen et long termes sur les compétences requises par le marché du travail et à encourager les partenariats entre les universités et le monde des entreprises afin de stimuler l'insertion des générations nouvelles sur le marché de l'emploi, tout en contribuant à la création d'une société fondée sur la connaissance, au développement de la recherche appliquée et à la création de meilleures perspectives d'emploi pour les jeunes diplômés; 63. demande aux États membres et aux partenaires sociaux de fixer des objectifs pour réaliser la participation égale des hommes et des femmes, de fournir des chances égales d'accéder à l'éducation et à la formation, des systèmes de recrutement ciblé, des programmes d'apprentissage spécialisés et des initiatives de formation à destination des femmes, des migrantes et des migrants, des chômeurs de longue durée et des autres catégories de personnes discriminées sur le marché du travail; 64. encourage les États membres à utiliser le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour mettre en œuvre les objectifs européens, pour promouvoir de nouvelles compétences, y compris pour de nouveaux emplois durables, écologiques et de qualité; 65. demande aux parties prenantes responsables de suivre l'évolution de l'emploi en vue de rendre la formation professionnelle de base et l'apprentissage tout au long de la vie plus pertinentes; demande, dans ce contexte, aux États membres d'évaluer la faisabilité des fonds de transition destinés à gérer les besoins en compétences; 66. demande à l'Union et aux États membres d'intégrer parmi les objectifs du Fonds social européen la promotion de l'adaptation à une économie durable, afin de contribuer à l'augmentation de la durabilité des activités économiques et du développement des infrastructures; 67. rappelle que la dimension durable ne doit pas être limitée à la formation dans le domaine des emplois liés à l'environnement, mais doit être intégrée à l'ensemble des programmes d'enseignement et de formation, afin de promouvoir une culture du développement durable et de la conscience écologique; 68. met l'accent sur la valeur ajoutée du concept d'apprentissage tout au long de la vie et demande aux États membres d'établir un relevé détaillé du potentiel local afin d'organiser des formations axées sur la demande, en faisant coïncider les ressources disponibles et les besoins réels, et de restaurer le prestige de l'enseignement professionnel secondaire en fournissant un enseignement de haute qualité, notamment dans les régions où le potentiel local et les secteurs d'activité traditionnels exigent le plein développement de compétences et de connaissances spécifiques; invite la Commission à fournir aux États membres un appui technique suffisant pour recenser les besoins locaux et fait remarquer que les établissements d'enseignement secondaire de haut niveau pourraient contribuer à réduire le chômage des diplômés et conduire à un emploi durable; 69. souligne qu'il est important pour les États membres de recourir au Fonds social européen afin d'investir dans les compétences, l'emploi, la formation et le recyclage en vue de créer de nouveaux emplois et d'en améliorer la qualité au moyen de projets nationaux, régionaux et locaux; observe que les seniors, qui sont de plus en plus nombreux au sein de la population de l'Union, peuvent également mettre leur expérience professionnelle au service de ces initiatives; recommande aux autorités régionales et locales d'entretenir des contacts permanents et pertinents avec le milieu des affaires, le patronat, les syndicats et les ONG, afin d'avoir une vision à moyen et long terme des besoins du marché du travail; 70. reconnaît le rôle important des collectivités locales dans l'éducation, sur laquelle se fonde l'acquisition des compétences ultérieures, orientées vers l'avenir, y compris à travers la formation continue et la reconversion professionnelle; constate que, dans de nombreux États, les conditions pour l'éducation et la formation continue des jeunes, y compris de ceux qui ont quitté le système scolaire sans aucune qualification, relèvent de la responsabilité des autorités régionales et locales; encourage dès lors les régions à utiliser les Fonds structurels pour les infrastructures éducatives, avant tout dans les zones urbaines et les régions défavorisées et à permettre, grâce à ce soutien, une éducation scolaire complète et ouverte à tous; rappelle les possibilités importantes de formation offertes par la mise en réseau des collectivités territoriales avec les entreprises et les associations pour créer des emplois durables dans les domaines du transport public local, de la mobilité urbaine, de l'éducation et de la recherche-développement, et demande que l'accent soit mis sur l'égalité des chances; 71. affirme la nécessité d'établir des synergies entre les États membres, les partenaires sociaux et les établissements de l'enseignement supérieur, pour mettre sur pied les programmes d'études du niveau préuniversitaire et du troisième cycle et créer des matières axées sur le passage aux économies vertes; 72. est convaincu que les défis démographiques exigent une stratégie plus large qui combine la création d'emplois et la satisfaction des besoins émergents ou nouveaux du marché du travail européen; estime à ce propos qu'il faut encore progresser dans l'amélioration de la mobilité des travailleurs au sein de l'Union, notamment des chercheurs et autres professionnels, dans l'espoir d'arriver, sur le marché intérieur, à une Europe sans frontières; Une transition socialement juste 73. constate que la durabilité accrue des activités économiques peut impliquer des changements dans l'ensemble des secteurs industriels; demande à l'Union et aux États membres de veiller à éviter les sacrifices sociaux lors de la transition vers une économie durable et d'œuvrer à la création d'un environnement propice à une transformation socialement juste, qui minimise autant que possible les risques de la transition pour les travailleurs et leur en offrent tous les bénéfices; fait observer qu'une transformation socialement juste constitue la pierre angulaire d'un développement durable et la condition sine qua non d'une adhésion des populations européennes à ce changement; 74. souligne que les coûts qu'entraînerait une transformation mal gérée peuvent être bien supérieurs aux investissements à prévoir; demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux d'assumer conjointement la responsabilité d'une gestion préventive des changements; 75. souligne la nécessité d'intégrer l'économie durable dans le cadre de la responsabilité environnementale de l'entreprise et de la société ainsi que la possibilité de promouvoir la culture de l'économie et du développement durables via des programmes de formation s'inscrivant dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises; 76. rappelle que la création des conditions nécessaires au perfectionnement professionnel des travailleurs et à leur adaptation aux nouvelles technologies vertes afin d'éviter des pertes d'emplois, ainsi que la promotion de conventions collectives visant à anticiper le changement et à éviter le chômage, le renforcement de la sécurité sociale, la mise en place de systèmes d'aide au revenu et d'initiatives de formation sectorielle proactive constituent autant de mesures cruciales en matière de prévention; 77. appelle la Commission à soutenir au niveau européen la recherche sur les métiers de demain dans le souci de prévenir les licenciements économiques et de préserver les emplois au sein de l'Union européenne; 78. souligne la nécessité d'une coopération et d'une complémentarité étroites et efficaces entre les organisations internationales, et invite l'Organisation mondiale du commerce à mener des actions en rapport avec les dimensions sociales et environnementales des investissements et du commerce; 79. reconnaît que les ONG et les syndicats ont un rôle important à jouer dans le développement d'un potentiel d'emplois verts, en contribuant au processus de prise de décision, en tant qu'employeurs et en sensibilisant les citoyens; 80. fait observer que les organisations qui investissent dans des pratiques éco-efficaces contribueront à créer un meilleur environnement de travail pour les employés et pourront ainsi être plus productives; demande aux États membres de promouvoir le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) et d'encourager tous les secteurs économiques à aspirer à un enregistrement EMAS; invite la Commission, les États membres et les partenaires sociaux à intégrer les questions environnementales essentielles dans le cadre du dialogue social, à tous les niveaux de négociation, et tout particulièrement au niveau des négociations de branche; souligne qu'une transition socialement juste exige que les travailleurs jouent un rôle de partenariat participatif dans le processus; demande l'implication dans les entreprises de représentants des employés en charge de l'écologisation de leurs lieux de travail, comme défini par l'OIT, conformément aux pratiques nationales, afin de rendre plus durables leurs lieux de travail, leurs entreprises et leurs différents secteurs; invite les États membres et les partenaires sociaux à entamer une coopération structurée avec les acteurs environnementaux et les experts, de façon à se servir de leurs conseils en vue d'assurer la gestion de la transition; 81. invite l'Union à engager un dialogue systématique, avec l'aide des partenaires sociaux, dans le cadre de ses relations extérieures, en faveur d'une approche analogue du développement durable dans les autres parties du monde, de manière à garantir que les conditions du développement sont les mêmes partout et que la concurrence industrielle n'est pas mise à mal; estime que garantir une saine concurrence dans les domaines durables de l'activité productrice contribuera positivement à renforcer la sécurité et améliorer les conditions de travail des travailleurs; 82. demande à la Commission et aux États membres de lancer des campagnes d'information et de sensibilisation du public sur le développement d'emplois verts dans une économie durable; o 83. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.
|
| Avis juridique - Politique de confidentialité |

